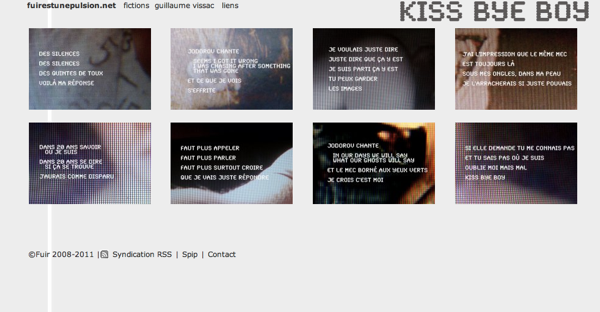Virginia Woolf
24 mai 20091928 : Virginia Woolf travaille aux Vagues (qui ne s’appellent pas encore Les vagues mais Les Éphémères). Parallèlement à l’écriture de ce livre, qui à ce moment là ne s’écrit pas encore véritablement, son journal archive l’évolution de sa vision littéraire, il enregistre comme un laboratoire les expériences qu’elle s’apprête à racler sur papier, il capte l’organisation fictive de son écriture à venir. C’est là toute la valeur des journaux d’écrivains : non pas tant de nous montrer l’envers du texte mais plutôt ses rouages, charnières et ses failles. Ce livre là n’existe pas encore, mais lentement se développe : c’est le stade du croquis, de l’esquisse, où tout se met en place sans pourtant y être. C’est en cela que ces Éphémères dont parle Woolf constituent déjà, en tant que tels, un livre fictif, un de ceux qui n’a jamais pu se trouver. Ainsi passent les jours et je me demande quelquefois si nous ne sommes pas hypnotisés par la vie comme l’est un enfant par une boule d’argent ? Et si c’est cela vivre ? C’est très rapide, brillant, excitant, mais peut-être superficiel. J’aimerais prendre la boule dans mes mains ; la palper doucement, ronde, lisse et lourde, et la tenir ainsi, jour après jour. Je vais lire Proust, je crois, et revenir en arrière, puis repartir en avant. 28 mai 2009Autre titre possible : Jamais perceptible pour les contemporains. Virginia Woolf, en début et fin de journal, évoque sa lecture d’Ulysse, d’abord à l’occasion de la parution du livre (1922), ensuite avec l’annonce de la mort de Joyce (1941). Ces impressions sont des notes de lecture : à la fois réactions crues-épidermiques et sereine lucidité de l’œil qui comprend, quasi instantanément, que la lecture du contemporain est pratiquement toujours vouée à l’échec : on écrit pour plus tard. L’œil est celui d’une lectrice ordinaire qui parvient à décrypter et comprendre l’Histoire Littéraire au moment où elle se construit. Elle le souligne très bien elle-même, d’ailleurs : « Une scène qui devrait figurer dans l’histoire de la littérature », écrit-elle. Je devrais lire Ulysse et en faire, pour moi, le procès, pour ou contre. Jusqu’ici j’en ai lu deux cents pages, pas tout à fait le tiers. J’ai été amusée, stimulée, séduite, intéressée par les deux ou trois premiers chapitres jusqu’à la fin de la scène du cimetière ; puis embarrassée, assommée, irritée et déçue par cet écœurant étudiant qui gratte ses boutons. Dire que Tom, le grand Tom, trouve qu’on peut comparer cela à Guerre et Paix ! A mon avis c’est un livre inculte et grossier, le livre d’un manœuvre autodidacte et nous savons combien ces gens sont déprimants ! Égoïstes, insistants, rudimentaires, stupéfiants et, pour finir, dégoûtants. Quand on peut se procurer des viandes rôties, pourquoi les manger crues ? Mais je crois que si, comme Tom, vous êtes anémique, vous pouvez trouver des vertus dans le sang frais. Comme je suis à peu près normale, je penche de nouveau très vite pour les classiques. Plus tard je réviserai peut-être ce jugement. Je ne veux pas compromettre ma sagacité critique. Je plante donc un bâton enterre pour marquer la page 200. J’ai fini de lire Ulysse et je pense que c’est un ratage. Du génie, certes, mais de la moins belle eau. Le livre est diffus et bourbeux ; prétentieux et vulgaire, pas seulement dans le sens ordinaire mais aussi dans le sens littéraire. Je veux dire qu’un écrivain de grande classe respecte trop son œuvre pour s’amuser à tricher, à choquer ou à épater. Je ne puis m’empêcher de penser à quelque galopin d’école primaire, plein d’esprit et de dons, mais tellement sûr de lui, tellement égoïste qu’il perd toute mesure, devient extravagant, poseur, braillard et si mal élevé qu’il consterne les gens bien disposés à son égard et ennuie sans plus ceux qui ne le sont pas. On souhaite que ça lui passe, mais comme Joyce a quarante ans, cela paraît bien improbable. Je n’ai pas lu le livre très attentivement, et seulement une fois, et c’est très obscur, de sorte qu’il est fort possible que je sois injuste et que les réelles qualités du livre m’aient échappé. C’est comme si du petit plomb vous grêlait la figure sans que vous risquiez pour autant une blessure mortelle, ainsi que cela arrive avec Tolstoï par exemple. Mais c’est complètement absurde de comparer Joyce à Tolstoï. Comme je finissais d’écrire ces lignes, L. est venu poser devant moi une très intelligente critique d’Ulysse, publiée dans la revue américaine Nation, critique qui analyse pour la première fois le sens du livre et lui donne ainsi beaucoup plus d’importance que je ne l’avais jugé. Mais je crois qu’il existe une vertu, une vérité durable dans les premières impressions, et je ne reviens pas sur la mienne, me réservant de relire certains chapitres. Il est probable que la beauté définitive d’une œuvre n’est jamais perceptible pour les contemporains. Mais ils pourraient du moins être fortement secoués, ce qui n’est pas mon cas. Ainsi Joyce est mort. Joyce qui avait à peu près quinze jours de moins que moi. Je me souviens de Miss Weaver avec ses gants de laine, déposant le manuscrit dactylographié d’Ulysse sur notre table à thé, à Hogarth House. Je crois que c’est Roger qui l’avait envoyée. Allions-nous consacrer nos existences à l’édition de ce livre ? Les pages indécentes semblaient si incongrues. Elle avait un air vieille fille, boutonnée jusqu’au cou. Et le manuscrit un dévidoir d’indécences. Je le rangeai dans le tiroir du secrétaire de marqueterie. Un jour Katherine Mansfield vint me voir et je le sortis. Elle commença à lire, à se moquer, puis déclara brusquement : « Mais il y a quelque chose là-dedans. » Une scène, j’imagine, qui devrait figurer dans l’histoire de la littérature. Il évoluait dans notre entourage mais je ne l’ai jamais rencontré. Et puis je me souviens de Tom dans la chambre d’Ottoline à Garsington, disant (le livre était déjà publié) : « Que peut-on écrire, après avoir réussi l’immense prodige de ce dernier chapitre ? » Il était pour la première fois, à ma connaissance, transporté, enthousiaste. J’achetai le livre recouvert de papier bleu et le lus ici un été, je crois, avec des frissons d’émerveillement, de découverte et de nouveau avec le longs intervalles de prodigieux ennui. Cela remonte à une époque préhistorique. Et maintenant tous les beaux messieurs sont en train de fourbir à neuf leurs opinions, et les livres, je suppose, prennent leur rang dans la longue procession. 21 mars 2010
Exemple : j’ai toujours du mal à poser première phrase dans mes fichiers, pas parce que je sais qu’ils seront lus dans l’instant (c’est pas forcément le cas), mais parce que j’ignore comment entrer dans une entrée Journal. Des fois je me dis : et si c’était pas vraiment écrire Journal qu’écrire comme ça. Je cogite deux minutes puis j’arrête de cogiter : j’écris mon truc et puis voilà. Des fois je prends aussi tous les journaux dispos à portée de main et je vérifie : comment eux font pour entrer dans leurs fragments ? Je sélectionne au hasard des pages traversées par le doigt un échantillonnage de fragements attrapés, liste exhaustive et étude comparée de quoi commence quoi et surtout comment. Je note la première phrase, ou les deux premières en fonction des cas, après c’est déjà plus le début. L’une de ces études, si elle existait réellement, pourrait poser le résultat suivant : Since I left writing here, I have had days of almost perfect health, days of illness too, and days when the Mood assailed me. (Larbaud) / Rêvé, dans la nuit, des tranchées durant la première guerre mondiale. (Jünger) / Conférence d’une certaine Mme Ch. sur Musset. Habitude qu’ont les femmes juives de faire claquer leur langue. (Kafka) / Ce n’est pas l’inconscient qui a surchargé mon livre de ce trop que je m’efforce d’éliminer. (Bauchau) / In the morning the conditions were unaltered. Went for a ski run before breakfast. (Capitaine Scott) / Mon fils Nathan. Mon cœur se serre souvent quand je pense à Nathan, mon petit garçon. (De Jonckheere) / Ma belle-soeur a appelé dans la matinée, elle est à New-York. Elle veut me vendre un vibromasseur à 90 dollars parce qu’elle en a acheté trois et qu’elle ne se sert pas de tous. (Warhol) / Je rentre at home par le 13 heures 44. Je scrute : pas trace de Gérard Longuet, ni même d’un obscur conseiller général de canton rural. (Didion) / Rouges et Blancs [de Milklós Kancsó] : nudité, rituel du déshabillage, extrême audace de scène du baiser « rouge » ↔ infirmière, indifférence atroce où surgissent quelques actes cruels (« rouges » jetés à l’eau et pieutés avec gaffe pointue), épopée nouvelle, temps étiré, syncopes, symbolisme des regards. (Guyotat) / Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Trafalgar, et hier fut le jour mémorable de la publication de Nuit et Jour ; mes six exemplaires me sont parvenus ce matin, et il en est déjà reparti cinq, de sorte que j’imagine cinq becs d’amis plantés déjà dedans. (Woolf) / Emotion. L’émotion vécue, impact ou contrecoup, est sans mots. (Emaz) Voilà les données brutes, à suivre pour analyse ? 19 octobre 2010Lors de notre dernier entretien, ma conseillère Pôle Emploi m’a remis un document vierge, à remplir pour notre prochaine cession (c’est à dire demain), et qui correspond à une sorte de journal de bord de mes recherches d’emploi. Je ne recherche pas d’emploi, mais ça je ne peux pas le lui dire. Je me contente d’être docile et de remplir le fichier comme un faussaire, en détournant, manipulant, créant des informations de toutes pièces, de faux CV, de fausses lettres de motivation envoyées à des entreprises fictives ou qui pourraient l’être, pour des postes qui n’existent pas ou ont déjà trouvé preneurs. Dans ma contrefaçon administrative je reste méticuleux, choisissant avec soins les offres malgré tout susceptibles de m’intéresser et/ou de me convenir mais dont je sais également qu’elles ne pourront pas conduire au stade de l’entretien d’embauche. Idem pour les fausses candidatures spontanées envoyées à de fausses enseignes qui ne recrutent même pas et ne cherchent pas à le faire. Ce n’est qu’à ce prix là que j’aurais la paix. Ou bien faire comme me le suggérait un ancien collègue, revu en septembre, et me présenter comme suit : « je suis Machin, écrivain, trouvez-moi du boulot ».
Cette fiction sur tableur ne m’a pris qu’une quinzaine de minutes, le reste du temps je continue les finitions du nouveau site Fuir est une pulsion, sur lequel je publie déjà, mais dans l’ombre. J’espère pouvoir terminer cette semaine. Et terminer aussi cette nouvelle entamée il y a un mois, Trois pylônes, et dont la première version n’est pas la meilleure, sans âme, sans grain, sans passion, mais j’ignore encore comment et surtout où la reprendre. Mais je m’en irai bien en Chine, à Chonqging précisément, les vols et les hôtels sont abordables, j’ai vérifié, oui mais pour y faire quoi ? C’est trop tôt pour développer les idées que je commence à avoir sur ma fiction chinoise, et c’est trop tôt, à peine après Coup de tête, pour me plonger dans un projet tentaculaire que je ne saurais pas, c’est sûr, contenir. Alors noter les idées qui me viennent, en attendant, et développer les quelques envies de texte que je peux avoir, croquer quelques lieux via Google Earth, construire des patrons de micro-situations. Je me limite.
Et Woolf comme impact pour recommencer à écrire ; je lis Les vagues. J’attendais une émotion littéraire capable de me submerger littéralement et me plaquer la tête dans le texte. Maintenant j’y suis (les deux extraits ci-dessous concernent le magnifique personnage de Rhoda).
Je reconnais dans ce portrait mental celui qui ne peut que penser, croisant d’autres corps, qu’eux, au moins, les autres, « existent mieux que lui ». C’est ce que je me suis dit rencontrant X. il y a six mois. Ce que je ne me suis pas redit dimanche, au salon de la revue, où nous étions censés nous voir, mais où je ne suis pas allé, grève oblige, dimanche n’arrangeant rien. Et plus généralement ce que je me dis croisant n’importe lequel de mes proches, ou ceux qui s’apprêteraient à le devenir.
20 octobre 2010Depuis plusieurs jours du mal à m’endormir. Pas d’insomnie, rien de tout ça, mais simplement savoir, yeux ouverts sur les chiffres rouges du réveil, qu’au fond la journée qui vient de couler entre les os et sous la peau n’a pas assez éprouvé le corps. Je suis pas fatigué mais me force à dormir pour sauvegarder un rythme pour moi automatique. Contraste sévère avec, six mois plus tôt, mes journées banales du boulot, qui m’épuisaient déjà à peine 22h passées.
Pour désamorcer l’état d’insatisfaction nocturne qui aime prolonger les heures au-delà des minutes, j’ai pris hier soir Les vagues, le bouquin sur les genoux, et j’ai continué de lire jusqu’à ce que mes yeux fatiguent rouges aussi dans les orbites, et sans verres pour déformer la vue. L’expérience a fonctionné, j’ai laissé mes yeux dans les pages, mais ne me suis pas endormi plus vite pour autant.
22 octobre 2010





23 octobre 2010Hier matin, à l’aube, entretien bref comme une virgule trop longue, quelque part dans le ciment d’Evry. Ensuite un train bien vite, malgré les grèves, pour Paris et pour m’extraire surtout du froid glacial (dehors et dedans) de la banlieue de banlieue. J’ai rendez-vous avec P. début d’après midi Et avec ces conneries d’anonymer tout le monde, dans les pages du Journal, forcément vient le jour où les lettres se confondent et se recouvrent les unes les autres, mais on a qu’une lettre, pas vrai ? Alors on pourrait dire que ces figures qui s’échappent, ces personnages que j’évoque très brièvement, sont des portraits cubistes, et bien fictifs aussi, comme si le P. que je décris au fil des semaines n’était en fait qu’une image sur laquelle on aurait collé des yeux, des bouches, des cernes issus de différentes figures bien réelles. Alors il est impossible de réellement savoir qui est qui, quand et où et c’est peut-être tout aussi bien.
et comme il est encore tôt je file au Musée d’Arts Modernes de la ville de Paris pour visiter l’exposition Larry Clark, celle qui a fait couler beaucoup d’encre, celle interdite aux mineurs. Et des mineurs j’en croise, du moins je crois en croiser, et si on me demande ma carte d’identité à l’entrée c’est uniquement pour appliquer le tarif moins de 25 ans, et je me dis que si j’étais venu avec P., l’autre P.. nous n’aurions peut-être pas pu rentrer. Dans les salles successives, passée la file d’attente, voyant aussi mon visage défiler dans les reflets des cadres, me suis rappelé ces mots, paroles d’une chanson d’Elliott Smith (Don’t go down) : « snowball in hell » et c’était carrément ça. De longues minutes hypnotisé devant le mur de photos saccadés d’un seul et même corps, j’ai pris une photo interdite, une photo à la main. Le reste du temps j’ai traversé Les vagues, et je m’enfonce encore.
Ensuite je suis passé au Louvre, la dernière fois que j’y ai mis les pieds, mis les pieds réellement, c’était il y a quelques années, F. était là, H. aussi. Cette fois-ci seul et gratuit je m’enfonce dans le département des antiquités égyptiennes, que nous n’avions pas pu voir à l’époque, en travaux je me souviens, et je m’assois quelque part où l’échos des pas au sol ne résonne pas trop contre les murs. La migraine se trouve dans chacun d’entre eux et j’essaye de l’étouffer. Je branche Les vagues, le podcast, j’en écoute deux au milieu des visages dans les vitrines qui sont aussi les miens, mais surtout des ombres vieilles de plusieurs milliers d’années. Le podcast est dans le désordre, l’annonce de la mort de Perceval arrive avant son départ pour les Indes, ce n’est pas grave, je continue. Je me perds un peu en sortant, me retrouve sans trop savoir comment dans la galerie des statues, ce n’est pas grave. Je sors côté Rivoli et rejoins P. aux Halles et je ne suis pas en retard. Nous nous trouvons à la Fnac. J’achète Open space, de Patrick Bouvet, mais rate Ecrivains en série, saison 2, introuvable dans les rayons.
P. et moi déjeunons dans une crêperie plutôt quelconque. La dernière fois que je l’ai vu remonte à deux ans, c’était aussi la première, alors nous nous connaissons mal. Résumer sa vie des deux dernières années correspond à un exercice de style rétrospectif assez hasardeux et j’apprécie qu’il « prenne en charge » l’essentiel de la conversation, je ne me tais pas pour autant. Lui et moi mis à part, nous parlons de Chuck Palahniuk, de Stephen King, de Roberto Bolaño. Je prononce réellement la phrase « t’es quand même pas une sainte nitouche » et une silhouette nous demande si on cherche du boulot. Je réponds non, je lui explique pourquoi. Lorsque je repars pour Y. ma migraine a disparu, j’y vois un lien de cause à effet. 24 octobre 2010
Dans toutes les langues que tu 3 connais tu répètes c’est pas moi qui ai appelé mais la tonalité qui m’a tiré de ma tête, et maintenant te voilà à insulter un inconnu, une voix dans la nuit qui crachote, ton reflet dans la vitre du 36e étage, le room service n’est pas passé, à supposer qu’on soit bien dans un hôtel, et un hôtel de luxe espérons, mais tu ne sais pas exactement. 4 La voix du téléphone encore, elle insiste. Pose le téléphone sur sa base, mets le haut-parleur. D’après elle (la voix) tu aurais demandé Q explicitement (explicitement), ou comme elle l’explique elle-même « le corps qui s’appelle Q, le corps à la boucle d’oreille en forme de Q, celui-là qui dore encore au soleil ». La lettre Q rayonne encore dans ta mémoire en suie, c’est peut-être la dernière lettre, et tu revois, certes, la boucle d’oreille, à droite ou à gauche peu importe, et la peau d’un corps sans visage, mais d’un corps qui persiste, le seul encore capable de transpercer le code de tes souvenirs indubitablement verrouillés, cryptés et mis sous clé. Oui, je veux Q : c’est toi qui parles, ta tête articule tous ces mots dans le reflet devant toi et tes dents crachent les sons sur les enseignes qui crépitent plus bas, dans le flou du centre-ville. Tu veux savoir combien coûte Q, tu entends la réponse, comment savoir si cette somme est la bonne et correspond bien à la réalité du marché ? Tu t’en fous. Tu exiges qu’il se déplace lui à ton hôtel - comment s’appelle votre hôtel ? - tu exiges qu’un taxi passe le prendre et le ramène à ton hôtel - quel est votre nom ? - celui que tu inventes est peut-être le tien, le vrai, qui sait, avec un peu de chance tu pourrais retrouver tes propres lettres sans savoir mais comment savoir, justement, quel hasard sera le bon ? Le nom que tu donnes n’est pas Orlando 5, le seul que Q pourrait connaître, mais Orlando ce n’est plus toi et tu ne sais plus au juste pour quelle raison il a sorti ce nom là d’entre ses lèvres et sans doute ta mémoire l’a déjà bouffé, ce nom, ce faux, cette marque en toc qu’on voudrait bien te tatouer sous les épaules. Tu demandes son âge, les mots s’imposent, et la réponse : l’âge que vous voulez qu’il ait. Tu raccroches. Le taxi paiera pour toi. Tu décroches à nouveau le combiné. Commande un taxi, donne tes instructions avant qu’elles ne s’écrasent contre un pan de ton crâne inconnu, d’autres recoins inaccessibles. L’homme s’appelle Q, dis-le, il porte une boucle d’oreille en forme de lettre, il est tout pour moi. Et tu réponds, et la voix te dit oui madame, oui monsieur, il est tout pour moi, ramenez-le. |
25 octobre 2010Nouveau rendez-vous Evry. L’équivalent d’un « atelier de groupe » organisé par un cabinet RH sous-traité par Pôle Emploi. Début 14h30, fin deux heures plus tard. Neuf autour de la table. Trois d’entre nous ne parlent pas très bien français. Nous apprenons à nous présenter. À la fin de l’atelier, notre formatrice nous fait passer des post-its sur lesquels dessiner au choix un soleil, des nuages ou de la pluie, afin de faire un peu de « météo-notation », savoir si cet atelier nous a été utile. Je dessine un soleil qui rigole. Le post-it est jaune.
Plus tard durant l’atelier, se présenter en début de séance : « bonjour je m’appelle Guillaume, je n’ai plus de travail depuis deux mois mais je me soigne. Mon rêve le plus fou, c’est d’en retrouver un ». 16 janvier 2011J’écris volontiers avec les initiales, ça me rappelle sans doute groupe de rap quasi homophone que j’écoutais mais brièvement, il y a bien longtemps.
31 janvier 2011
1
C. explique qu’il déteste Mrs Dalloway, c’est son droit. Il cite en exemple ce passage. Et l’un des adjectifs qu’il utilise est bien celui-là : « féminin », ce qui me hérisse le poil et je lui dis. Nous avons déjà eu, H. et moi, cette conversation X fois et X fois mes mots étaient les mêmes : il n’y a pas de littérature féminine comme il n’y a pas de littérature masculine. Je pense à V. chaque fois que j’y pense, comme aujourd’hui. Il y a plusieurs semaines déjà lui avoir envoyé l’image qui servira de couverture au prochain volume 8 de la revue TINA qui a pour titre « Gender surprise ».
Les Essais de Montaigne fourmillent d’anecdotes farfelues de ce type, ce qui fait dire à Guy de Pernon, traducteur et auteur des notes de cette édition adaptée en français moderne, que Montaigne serait crédule. La note 123, par exemple, précise que cette anecdote-là concerne « Marie la barbue », et, un peu plus loin, une citation extraite du Journal de Voyage en Italie : « Nous ne le sceumes voir parce qu’il estoit au village » et la note de préciser « ce qui ôte quelque peu de crédit à l’affaire... ». Ailleurs bon nombre d’autres remarques sexistes, malgré anachronisme, à ce moment là les notes précisent un brin amère que Montaigne était bien « un esprit de son temps ».
Le Diable m’explique, via Twitter, que c’est un livre qui me fera grandir et je le crois. Je suis déjà marqué au fer rouge et écrire n’est déjà plus écrire de la même façon.
C’est arrivé avec Référence #388475848-5, la première nouvelle d’Amy Hempel que j’ai traduite, il y a quelques mois. C’est arrivé : je l’ai traduite, et ensuite me suis rendu compte que le texte original ne comportait aucune marque de genre, aucune qui puisse permettre de deviner le genre du narrateur ou de la narratrice. Alors je l’ai repris, ce texte, et j’ai gommé, à mon tour, les marques de genre dans ma traduction. Même chose avec Jesus is Waiting, sauf que cette fois je l’ai vu avant, j’ai pu gommer de suite. La texte est plus long, les occurrences à modifier plus nombreuses, c’était plus délicat. Mais pas insurmontable. Le plus souvent, il s’agit simplement de modifier l’auxiliaire du participe passé : aller de être vers avoir. Hier évoqué cette question avec H., savoir si c’était indispensable, et pourquoi par exemple ne pas voir une logique de recueil ? Dans tel texte c’est une femme qui dit « je », on dirait alors que ça vaudrait pour l’ensemble du livre ? Mais ça ne me convainc pas. H. m’a dit : si tu penses que c’est important, ça l’est. Et c’est le cas. Je n’ai pas besoin d’en savoir beaucoup plus. 9 février 2013Dernière relecture (je parle de Coup de tête). En le lisant sais plus trop si c’est moi qui l’ai crit, si c’est moi qui le lis. Je sais rien. Mais c’est trop tard maintenant. Sais pas ce qui est trop tard au juste mais ça l’est. Pendant la relecture noté peu de chose (une coquille) mais je veux dire : mentalement noté peu de chose. Je saoule Gwen Catala pour la couverture. Fais des schémas sur Photoshop. Nettoie 25G d’octets de musique dure. Suis avec intention vraiment le journal au bord des vagues de Christine Jeanney. Elle traduit Les vagues de Virginia Woolf et tient journal le long. Juste après lecture du dernier journal posté je zappe sur le dernier épisode de L’Énéide traduit par Danielle Carlès et je me dis : y a quelque chose qui se passe en ce moment avec la traduction web, quelque chose d’important (et je parle pas de l’annonce lancée hier par Team Alexandriz pour libérer des livres sous droits bloqués par les droits de traductions, projet pas inintéressant d’ailleurs). Hâte aussi de lire le Wilde de Christine Jeanney, paru hier chez Publie. Y a de la viande dans les gyozas ? J’ouvre dedans pour voir. Un peu plus tôt lecture, avant séance d’Hitchcock, un bon film, agréable, du chapitre, je parle de Lotus Seven, du chapitre intitulé Échec et mat, et dont je note une phrase pour le listing adolescent, deux phrases, ces phrases :
Il est 23h50, j’ai juste dix minutes pour écrire mon Mueller (ça fait 56 mots) : Le désert est partout. Le sable est le sel de la 22 février 2013
Douleurs fantômes au torse (dans Coup de tête il dit : « on dit par torse on dit thorax »). Et elles ne sont pas fantômes non plus. Ce qui ne veut pas dire qu’elles n’existent pas pour autant. Elles sont comme celles qui saignent Tchernobyl depuis vingt ans : elles irradient. Aujourd’hui, à leur place, en surbrillance d’elles-mêmes, il y a des litres et des litres de vie sauvage, elles tourbillonnent, elles en gorgent les terres, elles s’écoulent, elles existent, mais j’ai manqué trouver où que ce soit la BD dont parlait il y a bien des semaines Seb Ménard sur son site, celle d’Emmanuel Lepage, je ne cherche pas beaucoup, je ne désespère pas. Fin du Portrait de Dorian Gray. Lis assez peu l’anglais traduit depuis maintenant quelques années mais là oui. La version de Christine est une très belle version. Aimerais atteindre cette élégance et cette fluidité dans mes traductions d’Amy Hempel qui ne sont que des balbutiements ou celles, non publiées nulle part, interrompues, de Joey Comeau. Ces lectures encouragent. Et vivement ses Vagues. Mueller (223 mots) : Une voix derrière le verre liquide d’Imke Leal. 28 septembre 2013
Je me sers finalement de ma Kaoss Pad hors sa boite pour un rythme électro qui est celui d’un piano qui, dans la réalité du jour, s’appellerait The Fall. Dans son toujours précieux journal de bord des Vagues, Christine Jeanney met en ligne un passage qui, outre la prémonition de la disparition de Percival, présente cette phrase en apparence anodine :
Je propose en commentaire deux versions de cette même phrase, l’une "Ulysse style", l’autre plus régulière :
Quant à la version de Christine, la voici :
Et je me rends compte, mais après avoir joué le jeu des méninges, après, aussi, avoir couru mes 19 min 12 (3.07km), avant que la pluie fine s’accroche à mes épaules, que cette version est plus douce, bienveillante, ce qui correspond bien à la langue de Louis, narrateur à ce moment des faits, affecté par la vision de son camarade qu’il vient d’avoir (une vision de sa mort). Cette idée de douceur fait naître en moi, bien indépendamment de ma volonté propre, et fort désagréablement je dois dire, l’idée que ce serait une langue féminine, ce à quoi je ne crois pas, ce qui m’a toujours écœuré. Cette pensée automatique a au moins le mérite de me faire réaliser quelque chose : mes traductions à moi sont agressives, manquent de douceur. Ca peut parfois se prêter à l’Ulysse : tant mieux. Moins, par exemple, à Amy Hempel, qui mâche une langue assez onctueuse, finalement (la brièveté n’implique pas forcément la sécheresse). Voilà ce que je dois creuser dans cette partie de mon travail. 16 octobre 2013À quoi douze ans acheté deux Quatre fantastiques, c’était bof. Jamais d’autres comics. Mais tombé par hasard sur ce truc, Private Eye, diffusé directement en ligne, sans DRM, et sous formule « In Rainbows », où tu fixes toi-même le montant que tu souhaites leur payer (même 0). J’ai pris l’épisode un pour rien, un peu plus pour les autres : 1$, 1.20$, 1.50$ (c’est trop, pas assez ?). L’image citée ici est prise au volume 2. Et indépendamment de ce que je peux en penser (c’est sympa, j’aime les têtes de bestioles), ça me fait réfléchir sur /// : le mode de monétisation. C’est un truc qui me plairait, à voir où l’intégrer, à voir comment difracter les contenus, peut-être construire des PDF ou des epubs pour des tronçons entiers, des épisodes, et qu’on pourrait acheter ? Réflexion vive. Par ailleurs une idée : écrire des lettres de réponse corporatiste à des contestations clients (ce que je fais dans la vie grise quotidiennement). Comme dans Overqualified, en faire toute une série, mais d’une seule entreprise. Elle commercialiserait quelque chose comme des corps, des organes, des squelettes et des germes humains, synthétiques mais humains. Le mieux, ce serait d’en faire un podcast, une lecture. Curieusement, la voix que j’ai en tête me vient de The Trees, c’est pourquoi je l’entends avec, en fond sonore, le bruissement de l’orage (mais en réalité, c’est peut-être autre chose). Une autre voix me vient des Vagues, une lecture en anglais, trouvée je sais plus où, en MP3 sans doute, mais sans aucun rapport, cette fois, avec aucun orage (la voix disait je me souviens : she turned the page). 16 décembre 2013Tu assistes au premier match de l’équipe de France pour le mondial 2014 (la Suisse c’est la Yougoslavie). Deschamps est sur le terrain dans un milieu à trois avec Matuidi et Thiago Motta, et si tu es bien conscient du paradoxe temporel que cela provoque chez l’un, l’incohérence de nationalité de l’autre ne te choque pas. Après l’ouverture du score par Ribery du pointu (un but très Fifa 13 et très Lucas Moura), la Yougoslavie égalise sur corner. Tu apprendras par la suite, un peu sonné, que François Hollande a été remplacé par un Chirac sénile et chancelant. Off. Tu déambules au pied de l’avenue Kennedy, près des villas privées des riches. Tu ouvres pour la première fois un Chandler qu’on t’a prêté il y a bien des années (mais un prêt numérique est un don, nul besoin de rien rendre). Tu te souviens il y a plus longtemps encore avoir aimé une très belle reprise d’Only you, introuvable aujourd’hui, et dont tu as tout oublié, y compris le nom du groupe ou de l’artiste qui l’interprétait. H. et toi assistez à l’enregistrement, au théâtre de l’Odéon, de l’émission des Bibliothèques de l’Odéon consacrée à Joyce, qui a le mérite de proposer quelques courtes lectures de Denis Podalydès, entrecoupées de longs monologues ineptes de Yannick Haenel. Ce qui intéressent Haenel et Paula Jacques, semble-t-il, c’est de savoir si Joyce est bien le plus grand, si c’était un bon vivant et comment il se comportait avec les femmes. Quant au fait d’avoir confié les dernières pages d’Ulysse à la voix de Molly Bloom c’est évidemment un acte féministe, mais bien entendu on se moque doucement que Virginia Woolf n’ait pas aimé ou pas compris Ulysse (qui, comme tu l’as trop souvent entendu, et notamment au cours de tes études universitaires, parce qu’elle était une femme, se serait retrouvée choquée par la crudité du texte ; en réalité sa réaction à la lecture contemporaine du texte est assez différente, et très intéressante à de nombreux égards, et notamment sur la difficulté pour un contemporain de faire face à un classique publié de son vivant, texte que l’on reconnaît comme tel mais qu’on sait déjà destiné à une autre postérité, c’est dit dans son journal, tu l’as déjà cité ailleurs, c’est particulièrement précieux à lire, et c’est donc une redite mais ça ne fait rien). Tu n’as jamais lu un seul livre de Yannick Haenel et ça ne t’en donne pas envie. Tu as reconnu dans sa démarche, dans son énonciation, dans la vacuité même de toutes ses analyses, une sorte de portrait croqué par Bolaño, un genre d’auteur des ministères, et, sans que tu saches réellement pourquoi, tout te conduit à nouveau vers le manifeste infraréaliste distribué l’autre jour : « CHERCHEZ, Y A PAS QUE DANS LES MUSEES QU’Y A DE LA MERDE ». 9 mars 2014Enfouie sous les tambours du Bronx qui défilent dans la rue et chuchotée par l’onde FM dessous l’eau : la mort d’Alain Resnais. Découvre le chantier ouvert par Sabine Huynh, une traduction d’Orlando. M’étais dit ces jours-ci, j’ai oublié pourquoi, comment, qu’il faudrait le relire, je ne l’ai lu qu’une fois, au cours de mes études, mais pas pour mes études, en L2 ou L3. On m’a dit récemment que le personnage d’Orlando faisait partie de la League des Gentlemen extraordinaires (c’est peut-être pour ça), fait également une brève apparition dans Moon Palace, si je ne m’abuse de nuit, sous la pluie new-yorkaise. Dans un des croquis préparatoires pour ///, j’en avais fait quelque chose, un O. amputé de ses lettres, mais ça venait de là. La première phrase est forte.
Comme prévu, termine le premier jet de Transoxiane deux. Un peu moins de 30 000 mots, 170 000 signes, soit un tout petit peu plus que mon épisode un clean (l’équivalent de ce que je dois couper sans doute). Le relire une première fois, le réécrire un peu, puis le réécrire net lors du troisième passage. Finir probablement fin mars. 20 août 2014Il y a un tigre quelque part. Il attaque un gus de reality show. Quelqu’un perd l’un de ses membres et tombe dans l’océan, à pic avec la bête à plusieurs mètres de fond. Ce qui le tue ce n’est pas le manque d’oxygène mais le poids de l’eau sur lui, eau dont on dit qu’elle pèse l’équivalent d’au moins onze océans (océans dans le sens de dimensions parallèles). Dans un Grenier avons trouvé six livres à quatre euros les six : Cortázar, Aldiss, Volodine 7. Commencé à lire et puis relire la nouvelle traduction de Jean-Yves Cotté de Trois Guinées (Virginia Woolf) pour Publie. Le soir venu Heathcliff déterre le cadavre de Cathy dans une adaptation douteuse des Hauts de Hurlevent. 27 août 2014C’est l’histoire d’une psychotique de l’espace dont on suivrait les aventures de série en série 8, de spin off en spin off entre les galaxies et les vaisseaux spatiaux et qui finirait, à l’aube de notre monde contemporain, directrice marketing quelque part. Cette insupportable bonne femme, bien sûr, ce serait quelqu’un d’autre. Le ciel est blanc. H. dort et Nesko dort et la métronomie des heures nous couvre le dos. J’en suis arrivé à la moitié de Trois guinées, dont je relis la nouvelle traduction pour Publie et je note : Penser est un devoir. Pas compté le nombre de fois à j’ai fait contrôle alt C mais peut-être que Libre Office le sait (quand bien même : je n’aurais pas de point de comparaison). Je regarde de loin les vélos, je me demande (aussi) où je souhaiterais rouler (comprendre non pas où mais bien sur quoi). J’ai ouvert tellement de chantiers parallèles que je n’ai pas fermés (les corrections de traduction d’Amy Hempel, les trucs de Leonard Cohen, le journal de Coup de Tête, le Mueller en rouleau, le Transoxiane trois, et quarante autres trucs dont je n’ai pas parlé ici) que je devrais me sentir submergé mais c’est faux. Je me sens autre chose. À Morlaix (c’est fermé). Des bouquins d’occasion : un Julián Ríos. Une caisse entière de Verdier, tous les mêmes, quatre ou cinq exemplaires déclinés en quatre ou cinq copies du même livre et ça sent le pilon 9. Parmi ces livres, un Vitaliano Trevisan, ce qui me fend le cœur. Dans Les portes du ciel, Cortázar dit d’un vieux qu’il possède une main qui lui fit l’effet d’une sardine vivante. Un peu plus loin : Ici, il me paraît opportun de préciser que j’allais à ce bal pour les monstres. Un peu plus tôt (mais après la phrase de la sardine) : Nous allions ensemble au bal et moi je les regardais vivre. 31 août 2014Termine doucement, lentement, ma première relecture de Trois guinées en terrasse d’un bar tout au bord de la mer, il doit probablement faire dans les vingt-cinq degrés Celsius, la mer est noire sous mes verres 4 et le soleil gagne du terrain sur à peu près pas mal de choses (c’est oblique). Peu écrit le journal ces derniers jours. Pas vraiment écrit du tout ces dernières semaines. Mis dans un mail à V. que c’était un problème ; ou que ce n’était pas un problème, je ne sais plus. J’essaye de résoudre à peu près tout par l’oxygénation. Parfois ça marche. Puis suivre le sentier côtier le long de la falaise jusqu’à ce qu’il s’entortille dans la végétation et qu’il s’écrase dans le sable d’une plage plus ou moins mi-sauvage. Marché via l’eau jusqu’à l’ombre plongeante de la falaise et un rocher pour lire des manuscrits. Deux gars sur un Frisbee. Trois jouent au rugby dans le sable. Un père dit à sa fille de cinq-six ans tu es con ? tu es con ? tu es stupide c’est ça ? Un mec fume ses lunettes de soleil, je l’ai pris en photo. Je suis absolument seul et me sers de mon t-shirt vert, celui qui dit partying is such a sweet sorrow, comme dossier. 1er septembre 2014Il n’est malheureusement toujours pas possible de se brancher un écran 13 ou 14 pouces Eink pour pouvoir travailler sans se faire mal, au yeux, à ce qu’il y a de l’autre côté de nos yeux, à ce qu’il y a encore au-delà, mais il est possible de moduler les réglages de l’écran du Macbook (je le fais depuis longtemps maintenant) et d’utiliser des applications annexes comme Nocturne qui permet de rendre l’écran monochrome, de masquer par exemple la barre supérieure inactive (et donc d’effacer l’heure permanente) et, si besoin, d’inverser les polarités blanc / noir, pour lire la nuit sans s’éblouir. Il est également possible d’aller plus en profondeur dans les paramètres d’écran pour en modifier l’affichage, je ne m’y suis pas trop perdu. Il y a des choses à faire. Mis en place aujourd’hui le système d’affichage des mots clés dans Ulysse qui permet la lecture en split-screen d’une même heure. Ici l’exemple porte sur la première minute du texte, 8h, où l’on peut lire à gauche l’arrivée de Stephen au sommet de la tour Martello et, à droite, l’irruption de Leopold Bloom qui aime à déguster les organes des bêtes et des volailles. C’est important. Le journal des Vagues a repris. Je le lisais justement dans Babel & blabla, de Michel Volkovitch, il y était question des Vagues, je m’étais dit alors : où sont celles de Christine Jeanney ? J’ai presque terminé ma relecture de Trois guinées, toujours Virginia Woolf, c’est un tout autre rôle pour moi, qui me renvoie perpétuellement à ma propre ignorance (elle est vaste). Il faut vite replier ces craintes, en faire une boule de papier blanc, l’enfouir au fond du sable de sa poche et se mettre au boulot. Et n’écouter que son crâne vide. 8 septembre 2014Termine la relecture de Trois guinées pour Publie. Je pensais clore dimanche mais dimanche pas le temps. Aujourd’hui c’est un autre dimanche. J’ai des lacets de couleurs différentes sur un pied et sur l’autre, peu importe. J’ai du retard dans mes mails, j’essaye de combler le retard dans mes mails et mon écran très basse consommation m’affiche du noir et blanc, c’est bien. Rouvert le Transoxiane trois pour la toute première fois depuis plus d’un mois, un mois et une semaine si j’en crois la date automatique qui s’inscrit à l’intérieur du texte et... c’est tout. J’ai dû procrastiner. Or il faut le relire. Je veux dire, bien sûr qu’il faut le relire, mais il faut aussi le relire, tout simplement car j’ai oublié presque tout ce que j’ai mis (ou imaginé, ou dessiné en pointillés dans l’hors champ de la page) dedans. 4 octobre 2014Reprise du Mueller en rouleau. Cela signifie tout relire depuis le tout début jusque là où je me suis arrêté l’année dernière (je crois bien que c’était l’année dernière), après cinq-cent et quelques vers. Il y aura quelques notes à revoir, la préface à réécrire, peut-être ajouter des fragments ici ou là pour allonger le truc (encore que). Dans la foulée des relectures une note 34 qui concerne les criquets que les tourks se mettent dans le ventre. (34) "Les tourks croient Déambuler dans un supermarché culturel en quête d’une petite enceinte bluetooth pour avoir un meilleur son le soir, pour des films ou des séries dont les images sont crachées sur le mur, le grand mur blanc. Pour la musique c’est mieux aussi que les enceintes intégrées au Mac, mais ce n’est clairement pas conçu pour écouter des trucs où le silence est prégnant. Pour les boum-boum ça passe, pour le piano ça crache pas mal dessous. Écrit le premier jet d’une quatrième de couverture pour la sortie de Trois guinées à paraître fin octobre. Le premier jet est trop long, et trop de citations. Il faudrait faire plus simple. À terminer demain. Pour le reste : j’ai rendu compte du jour à l’envers ici-même. J’ai revu mes priorités. J’ai cassé d’autres lacets tout noirs. 4 octobre 2014Reprise et réécriture partielle de la quatrième pour Trois guinées, la fait relire par H., l’enverrai dans la journée sans doute. Parution prévue le 23 octobre.
Réécriture partielle aussi des deux premiers chapitres du Transoxiane quatre. C’est mieux, probablement, mais je suis trop resté en surface et je n’ai pas réellement renversé le premier jet raté. Il faudra donc refaire. Écriture également d’un chapitre trois jeté sur l’écran gris du Mac mais il faut bien l’avouer : sur toute une moitié de ce texte je n’ai aucune idée d’oùvaisje et je ne sais pas ce que je dis. Pour la construction du Mueller en rouleau, et parce que Dreamweaver merde depuis quelques semaines et m’inflige un message d’erreur agaçant au niveau de la sauvegarde des fichiers, je passe sur un truc open source qui s’appelle Blue Griffon (c’est bien mieux). À l’époque (c’est-à-dire à l’époque où je construisais des sites internet beaucoup plus qu’aujourd’hui, soit un temps ou pour publier un article il fallait l’encoder directement dans l’html de la page), j’utilisais un truc pour PC qui s’appelait HTML Edit, c’était très bien comme ça. Jamais apprécié Dreamweaver toute façon. |
↑ 1 Cette phrase « Toute ma vie, je resterai cramponné à la frange des mots... », peu importe combien de fois je la relis, je la relis toujours de la même façon, imitant ce lapsus de l’oeil que j’ai eu à première lecture, et qui transformait la frange en fange en bouffant vite la lettre, et cela disait donc : « Tout ma vie, je resterai cramponné à la fange des morts... »
↑ 2 Neville est une figure d’amoureux transi : Perceval est l’objet de son désir de jeunesse, regard momentané. Cette vision du désir homosexuel, qui se confond avec le désir d’adolescence, s’accroche à moi doublement. La fin du paragraphe remonte le temps dans l’hypothèse que dégagent ces phrases vers un futur probable : il « épaissira » signifie qu’il ne sera plus adolescent, « Mais en ce moment, il est jeune » ramène le temps au présent, c’est à dire à la contemplation du corps encore vert. « Rien, pas même un fil », etc. « ne s’interpose entre lui et », etc., plaque une peau neuve qui se détache en noir, silhouette entre parenthèses, lumière rasante, couché de soleil, venue de derrière, du côté de la fenêtre du fond, et une peau à vif, que rien encore ne caresse. La sentence exprimée dans cette vue prophétique de l’avenir (par ailleurs faux), n’est pas tant amorcée par l’évidence « il prendra femme » que par le détonateur véritable « il épaissira ». C’est ce « il épaissira » (ils épaissiront tous) qui ramène Neville « à la frange des mots ».
↑ 3 C’est une tentative. Le tutoiement comme compromis. Le personnage d’Orlando n’est pas un homme, pas une femme, mais successivement l’un et l’autre, simultanément les deux. Je ne peux pas dire « il » ou « elle », pas plus que je ne peux dire « je » dans ce récit éclaté. Le tutoiement apporterait ici une constante agréable, une ligne de fuite autour de laquelle organiser le chaos du récit. Je ne suis pas très satisfait du résultat, mais mets en ligne malgré tout. C’est aussi l’objet de ces fictions en ligne : les reprendre au fur et à mesure des relectures, du travail sur le texte, et d’en montrer aussi les corrections. Cette version 0 est une base de travail. Un point de départ à malaxer.
↑ 4 Cette scène pourrait introduire toutes les autres, ou tout du moins le personnage d’Orlando. Il/elle est malade de la mémoire, il/elle commande un gigolo dans son hôtel, une pute qui est un homme. Il/elle l’a déjà croisé auparavant, on ignore quand. Son signe de reconnaissance, sa boucle d’oreille. C’est à lui qu’on doit son surnom Orlando, une marque de sous-vêtement ou de parfum quelconque, ou les deux. Il/elle, malade de la mémoire, ne sait même pas où il/elle se trouve. Q c’est la seule image contre laquelle se raccrocher.
↑ 5 Orlando vient évidemment d’Orlando, de Virginia Woolf, l’histoire d’un homme, sur quatre siècle, qui devient femme au fil des pages. Une biographie transgenre. Le véritable nom d’Orlando, dans Chongqing, est oublié, celui-ci peut lui servir de bouée. Mais ce n’est pas définitif.
↑ 6 La version de Sabine :
Il — car même si la mode vestimentaire de l’époque pouvait induire en erreur quant à son sexe — était en train d’entailler la tête d’un Maure qui pendait à une poutre.
↑ 7 Le tout premier que j’ai lu : Des anges mineurs : lu puis foutu au rebut avant d’avoir rien lu : je n’avais rien capté.
↑ 8 Imaginons par exemple le décorum TV des années soixante-dix, puis quatre-vingt, quatre-vingt-dix, deux mille.
↑ 9 Ou plutôt le sauvetage du pilon.